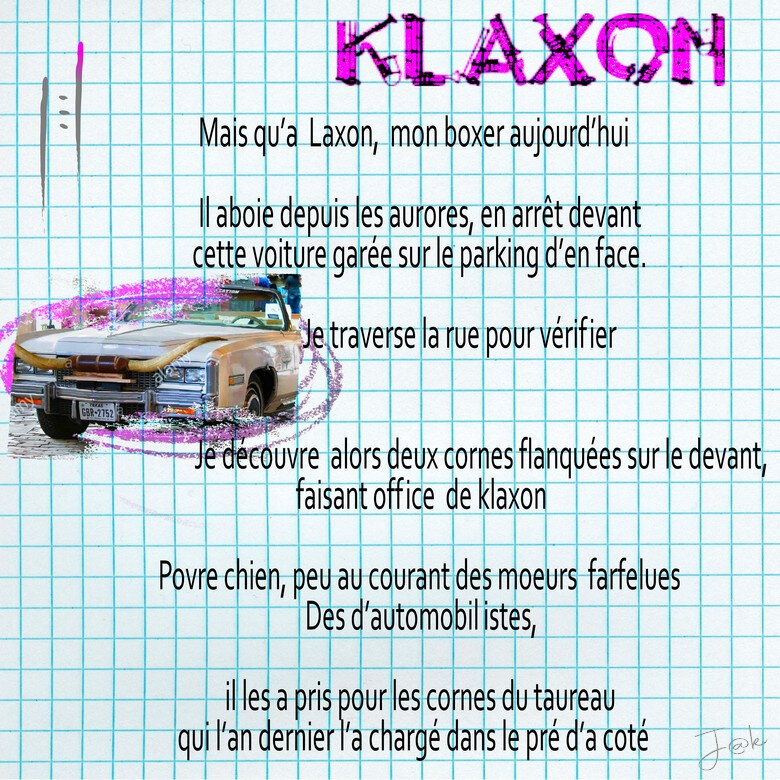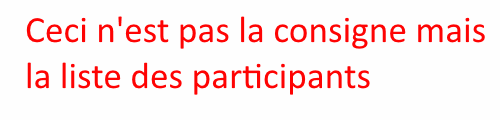Tôt, le dimanche matin, quand le temps le permettait, mon père partait à la chasse. Les aboiements contents du chien en train de grimper dans le coffre, les manœuvres de la voiture pour sortir du garage, la fermeture du portail et la lourde barre en fer du battant retrouvant son encoche, encore trop dans mes rêves d’enfant, je n’entendais rien. Ce n’est qu’au réveil, pendant le petit-déjeuner, louchant par la petite porte vitrée donnant sur le garage, que je m’apercevais que la voiture avait disparu…
Il n’était pas là, et c’était moi qui devenais l’homme de la maison ; pourtant, sa compagnie me manquait. Posé sur les coudes, étudiant patiemment les mots croisés du journal, il n’était pas le point de repère dans la salle à manger ; il n’était pas à la cave en train de faire le plein du seau à charbon ; il n’était pas du côté de sa bagnole, occupé à parfaire les niveaux du moteur. Son vide était plus remarquable que sa présence.
J’errais sur l’emplacement de sa voiture, cherchant un jeu pour occuper tout cet espace, mais mon imagination me ramenait toujours à son éloignement ; cette séparation me contrariait. Je n’entendais pas sa voix qui chantait parfois comme s’il était content de la seconde qui passait ; je ne le voyais pas se raser avec précaution devant la petite vitre du lavabo de la cuisine ; cherchant un câlin, je ne pouvais pas sauter sur ses genoux et l’occuper à moi. « Mais il va revenir !... », disait maman, agacée, comme si elle était sûre de ce qu’elle avançait. Et à qui je réciterais mes leçons d’école ?... Et à qui je demanderais de tailler mes crayons de couleur ?... Et à qui je montrerais mes plus beaux dessins de récitation ?...
La chasse, plutôt qu’une épreuve de viandard dominical, celle qui tue tout ce qui rentre dans le congélateur, celle qui rentabilise le permis à coups de fusil, c’était seulement une échappatoire pour mon père. Des sous-bois à peine éclairés, aux sentiers tortueux des collines escarpées, le fusil en bandoulière, il promenait le chien plus loin que notre petit chemin. C’était sa façon de se ressourcer en dehors du boulot, des contraintes et des soucis. Même bredouille, il revenait avec un bout de sourire aux lèvres comme s’il avait jeté ses valises d’adversité dans une combe profonde. Plus tard, j’ai eu l’occasion d’aller à la pêche, seul, et les sentiments de liberté sauvage et d’école buissonnière que j’avais, devaient être aussi les siens, à son époque.
Bien sûr, il ne dédaignait pas tirer sur un beau lièvre, un faisan ou un lapin surtout quand, après une longue course poursuite, son chien dressé lui présentait le gibier, pile, au bout de son fusil…
Vaquant à mes vagues occupations de jeux, je gardais pourtant une oreille attentive, du côté du dehors et du portail d’entrée ; quand un bruit de moteur approchait dans notre petit chemin, aussitôt, je fonçais pour voir qui c’était ! Ne connaissant pas encore bien les manœuvres de la grande et de la petite aiguille de l’horloge de la cuisine, souvent, je demandais l’heure à ma mère. L’avancement de la préparation du repas et ma faim grandissant, c’était mes seules impressions du temps. « Il va revenir !... », me récitait maman, comme si elle connaissait mon inquiétude…
Et puis, de l’avoir tant attendu, il arrivait, mon papa ! Triomphant, quand il ramenait quelque chose, il donnait deux petits coups de klaxon, en parvenant devant le portail ! C’était un signal convenu entre nous ! Personne n’aurait pu prendre ma place pour lui ouvrir les deux battants ! L’immense clé à tourner, la lourde barre, et les deux vantaux à écarter, c’était mon travail pour avoir la primeur de son sourire victorieux, pendant ses manœuvres de garage !...
Petit indien en liesse, tellement je dansais devant sa calandre, il devait faire attention à ne pas me rouler dessus ! Avec des appels de phares, il balançait quelques coups de klaxon et, surpris, je sautais en l’air ! Ça le faisait rigoler, mon père ; cela devait lui rappeler des souvenirs. Je crois qu’il était content de ramener quelque chose, juste pour faire plaisir à son gosse ; imaginez son poster géant qui représentait toute ma fierté…
À peine stationné, tel un roi sortant de son carrosse, pourtant fourbu par sa matinée de marche difficile, la première chose à son emploi du temps, c’était de faire descendre son compagnon de chasse et de lui remplir sa gamelle avec de l’eau fraîche. Avec une « langasse » longue comme le bras, le chien lampait tellement qu’il éclaboussait partout ! Il tremblait de tous ses muscles et semblait sourire en même temps ! Pourtant, il ne perdait pas de vue son chasseur comme si tous les deux, communiants du dimanche à l’office de la complicité, ils ne faisaient plus qu’un…
Homme des bois, fougères, champignons et châtaignes, il sentait la forêt, mon père. Sur son blouson griffé, il avait des épines de ronce plantées un peu partout ; des feuilles de chardon, des akènes et des « arapans* » étaient collés contre le bas de son pantalon et ses chaussettes ; je me disais qu’il devait prendre les mêmes pistes que le chien…
Pendant qu’il sortait précautionneusement le gibier du carnier, je louchais sur chacun de ses gestes jusqu’à ce que je reconnaisse la bête. Plus heureux qu’un gamin devant un manège, quand c’était un lièvre, ou un lapin, je sautais sur mes gambettes, en faisant des grands bonds en l’air ; quand je voyais des belles plumes, j’agitais mes bras et, je vous assure, mes « jambes de grive » décollaient du sol…
Enfin, dans la réjouissance de la maison, c’était l’heure de la remise du trophée ; mon père me tendait sa bestiole par les pattes et, solennel, précautionneux, j’allais la porter à ma mère. Le long du court trajet du garage, réunissant ses forces, le chien sautait tout autour du gibier en jappant ; ce que je traduisais facilement par : « C’est grâce à moi !... C’est grâce à moi !... », ou bien « Je l’ai aidé !... Je l’ai aidé !... » Du bout des doigts, mes sœurs caressaient le pelage de la bête, et m’man calculait déjà le plat dans lequel elle allait cuisiner l’animal…
*Épis d’herbes sauvages